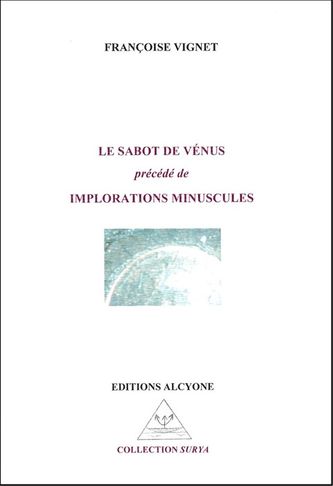Partagez cette page
Voir la présentation du second recueil de F. Vignet, Le sabot de Vénus, sur la page 2.
Journal de mon talus, de Françoise Vignet
Editions Alcyone (Collection Surya
Françoise Vignet est née en 1949 à Saint-Etienne (Loire). Devenue professeur de Lettres, elle a aimé exercer son métier, tout en voyageant en Europe et en Extrême-Orient. Le commerce des poètes l'a accompagnée tout au long de sa vie.
Retirée dans le Gers, "à l'écart du monde", elle a fondé en janvier 2011
"Vous prendrez bien un poème ?", feuille poétique qui s'adresse à près d'une centaine de lecteurs ‒ poursuivant ainsi le partage.
C'est là qu'elle a composé les proses de "Journal de mon talus",
inspirées par la présence de la grande campagne. (Recueil nominé, sous une forme sensiblement différente, lors du Prix Troubadours/Trobadors 2014, décerné par la revue Friches, de Jean-Pierre Thuillat. Recueil qui
a inspiré à Claudine Goux douze aquarelles.) Des extraits en ont été accueillis dans les revues Arpa, Décharge, Friches, Les Cahiers de la rue Ventura, Poésie/première.
Elle a été,
de 2014 à 2017, membre du comité de rédaction de la revue Les Cahiers de la rue Ventura, revue créée et dirigée par Claude Cailleau. A partir de deux collages de Ghislaine Lajard, elle a participé à un
livre d'artistes "Voyage autour d'un collage" et à une "Riche Enveloppe".
**
Textes
Nous sortons pour planter le pêcher.
Au lieu du grand silence d’ici et de ses bruits de vent, une clameur, mi- articulée, mi- roucoulée, à voix si aigües que féminines, comme en une langue étrangère.
Les grues ! Les grues cendrées sont de retour.
Et le regard s’élève, scrute le bleu et les nuages blancs, s’égare, avant de contempler enfin, tout au fond du ciel, les très hauts vols mouvants - innombrables variantes de V non enchevêtrés, qui ne cessent de se recomposer savamment.
Et l’esprit se déroute, fasciné par ces rythmes millénaires des bêtes et des lunes, qui font de nous des humains si petits, soudain, parmi l’immensité des ciels.
Mars
A peine audible, un bruissement emplit l’espace et lui redonne sa profondeur de grand château à ciel ouvert. Un souffle doux meuble les airs d’une immobile pulsation.
Et
nous voici parmi la pluie !
Hôtes – en sa demeure, en son silence qui bruit menu, en sa fraîcheur. Hôtes d’un jour et bouche-bée en sa présence ‒ immense.
Juillet
Le pays d’ici
Ici, la nuit est sombre, parfumée et la petite route, parfois inondée de lune pour une balade improvisée – la maison, posée au bord de la Voie Lactée.
Ici, l’on écoute le silence : bruissement de ce jet d’eau végétal qu’est le tremble, roucoulement des tourterelles turques, froissement d’ailes dans les feuilles touffues, appel plaintif de la hulotte, friselis des maïs séchés sous le vent…
Ici, la fenêtre ouvre sur un coteau brodé de vignes hautes et sur le méandre de la départementale, qui s’étire en pente douce vers le clocher.
Ici, les petits chemins mal goudronnés portent en leur centre une ligne herbue, parfois hachée, parfois ornée de touffes vertes, et, sur leur côté ensoleillé, un double feston, tout noir : l’ombre des fils du téléphone.
Ici, au détour d’un virage grand ouvert sur l’espace, c’est l’horizon à nu qui soudain vous saisit… et le cœur qui bondit !
Août
La porte s’ouvre sur la nuit. Et la fraîcheur soudain au visage me drape : exquis allègement.
Ciel gris blanc pommelé entre étoiles sur fond d’azur.
De ce côté-ci du silence, à l’ombre claire des arbres, repose un monde autre - présence souveraine.
Septembre
A contre-ciel, le tremble ne bruit plus – ses feuilles d’or frais sur le pré vert éparpillées.
L’été s’en va contre un ciel bleu rosé. Lentement chutent les feuilles ensoleillées : cérémonie discrète, léger bruit sec. S’annonce le temps du dépouillement.
Tremble sois-tu – et de bois vert : à toi de bruire en tes feuillets.
Septembre
L’hiver a envahi la terre, celui qui glace et éblouit.
Bosquets de givre et ciels purs. Grand silence sans loups. Espaces lumineux où se coule le corps.
Peu à peu s’esquive
la fatigue de l’âme.
Décembre
Françoise Vignet, extraits
de Journal de mon talus
© Editions Alcyone
- Vous pouvez écouter des poèmes de Françoise Vignet
en cliquant sur la flèche du fichier MP3, en bas de page.
- Pour vous procurer le livre de Françoise Vignet :
/ envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : editionsalcyone@yahoo.fr, nous vous enverrons alors un Bon de commande.
/ Vous pouvez commander ce livre en librairie.
/ Cet ouvrage est en vente sur www.amazon.fr (taper
: "Françoise Vignet").
Note de lecture de Jean Pichet sur Journal de mon talus de Françoise Vignet :
Journal de mon talus est un journal sans dates. Le temps, ici, le temps du calendrier, des montres, de l’actualité, de la vie privée ou sociale est laissé
de côté, au profit du temps des saisons, évoquées par les mois que l’auteure place comme en sous-titres des brèves proses qu’elle a rassemblées dans cet ouvrage.
Françoise
Vignet se veut réceptive à ce qui survient dans le lieu où elle a choisi de vivre en poète. Elle saisit ce qui la saisit ; elle accueille ce qui l’accueille ; elle note ce qui, à certains moments, lui donne
le sentiment d’être corps et âme, esprit et cœur, en communion avec le monde naturel, qui semble s’enchanter lui-même, naturellement. Les eaux d’un étang sont des ciels (p.19). Un plaqueminier
est l’Arbre du Jardin des Pommes d’or (p.18).
Mais ces enchantements ne semblent pas être, pour elle, l’important. L’important, pour Françoise Vignet, c’est de se faire accepter, accueillir
par cette beauté qui nous est a priori étrangère – qui ne nous doit rien. D’y prendre place, de s’y « glisser », d’y « dévaler », d’y vivre absolument, ne
serait-ce qu’un instant, mais un instant qui « n’est plus fraction de la durée » (Avant-Dire). Un instant ouvert immensément, vertigineusement, légèrement, « telle une faille dans le
temps » (p.14).
D’où surgit le poème.
Et c’est comme si le Paradis était retrouvé. Furtivement. Des miettes de Paradis pour notre faim de beauté. Pour celles et ceux
qui veulent bien les recueillir, même si elles sont immatérielles.
Jean Pichet
Journal de mon talus, Françoise Vignet
Prix global en euros : 15,00€ (+ port /emballage : 4,00€)
Poèmes de Françoise Vignet dits par Silvaine Arabo
Françoise Vignet
Françoise Vignet
Françoise Vignet
Le sabot de Vénus précédé de Implorations minuscules, de Françoise Vignet
Editions Alcyone (Collection Surya)
Recueil accompagné de deux photographies.
Françoise Vignet est née en 1949 à Saint-Etienne. Devenue professeur de lettres, elle a aimé transmettre, tout en voyageant en Europe et en Extrême-Orient. Le commerce des poètes l’a accompagnée tout au long de sa vie ainsi que la pratique, confidentielle, de l’écriture. Retirée dans la grande campagne, elle a fondé en 2011 Vous prendrez bien un poème ? - feuille poétique qui diffuse des poètes contemporains à près de 150 lecteurs, poursuivant ainsi le partage.
Elle a collaboré à la revue Les Cahiers de la rue Ventura et participé, à partir de collages de Ghislaine Lejard, au livre d’artistes Voyage autour d’un collage, à une Riche Enveloppe (2016) et à un Livre Pauvre (2021). Ses poèmes ont paru dans les revues Arpa, Décharge, Friches, Interventions à Haute Voix, La Grappe, Les Cahiers de la rue Ventura, Poésie/première & Verso.
En 2017 paraît aux Editions Alcyone Journal de mon talus, « une belle méditation fusionnelle avec la nature au fil des saisons », selon Jean-Marie Alfroy ; ce recueil, nominé au Prix du poème en prose Louis Guillaume 2018, inspira à Claudine Goux un livre d’artiste avec douze aquarelles.
*
Lorsque l’existence brutalise, l’écriture, nécessaire de survie, se resserre. Implorations minuscules évoque la disparition d’un être cher :
« Chante, vif invisible, chante à pleine gorge ce qui me noue la gorge. »
Le Sabot de Vénus, dédié au bien-aimé, s’essaie à explorer l’affliction, notamment cette réclusion singulière qu’elle engendre :
« Me voici sur le chemin de crête, le regard sur chaque versant, celui des morts où tu es allé, celui des vivants où je suis restée. Sensation d’étrangeté. », ainsi qu’à inventorier la perte, source de rêves, objet de constats :
« Ta mort donne à notre vie, désormais scellée, son relief singulier, sa brillance unique. »
au cours de ce qui devient un hommage à l’être aimé, « trésor à jamais perdu » :
« Te rencontrer fut un enchantement, bientôt glissé dans la trame des jours. »
De temps à autre cependant, tu apparais, passant mystérieux quoique familier, dans mes rêves.
Il y a peu, cavalier à cheval, tu t’élançais dans les airs lumineux du haut d’une falaise abrupte jusqu’au profond de la mer étincelante.
Echappée vers l’éternité ?
Plus récemment, tu regagnais la maison, à la main un tapis d’Orient, chatoyant, de soie blanche et bleue.
Offrande de frontalier.
Françoise Vignet, extrait de Le sabot de Vénus
© Editions Alcyone
TEXTES
Implorations minuscules
à mon frère Denis, i.m.
L’ossature des arbres, noirs sur un ciel nu – et le couchant laiteux au loin. Règne du morne.
Seul, un oiseau - là-haut - s’affaire à son chant.
Le lance, le reprend, le détaille …
Chante, vif invisible, chante à pleine gorge
ce qui me noue la gorge.
Que ton chant rejoigne celui qui s’éloigne.
Que ton chant lui soit compagnon
En notre infinie douceur.
4 mars 2019.
Sans cérémonie (funéraire).
L’air est vif au matin d’hiver – et la campagne, vert amande, sous la mince gelée blanche, soie transparente.
Entre le givre et l’herbe, je me glisse, proche des morts aimés. De cet abri éphémère, je lis le monde en son envers – légère, détachée
Bientôt dissoute dans la lumière.
Mars
Sous la voûte des hauts platanes, qui m’est refuge, le chagrin n’est pas volage.
Il se recueille, se décline en jeunes feuilles, transparentes de ciel.
Le chagrin se porte en printemps, en pousses drues. Et l’angoisse fait provision de bourgeons.
Voici venu le temps des brises – le temps brisé.
Avril.
Le Sabot de Vénus
à Claude, mon amoureux de mari, i.m.
A nous deux
Elle et lui s’en doutaient : l’heure du voyage approchait.
Nul préparatif achevé. Nul bagage bouclé.
Inutile de s’agiter.
Ils avaient déjà appris à voyager léger,
à franchir les cols,
à progresser, pas à pas, dans l’immensité des espaces
– plus précisément dans cet espace singulier,
conquis avec l’endurance de l’arpenteur de montagnes,
cet espace où terre et ciel s’épousent si bien
qu’ils épousent aussi ce(ux) qui du monde mortel arrive(nt) là *,
là où, au croisement des points cardinaux, les drapeaux de prière
adressent à l’univers, par la grâce des chevaux du vent,
leurs paroles bienfaisantes.
Elle et lui s’en doutaient. L’heure du Voyage approchait,
dont la destination leur était inconnue.
Mais l’un et l’autre le savaient : l’un s’envolerait, l’autre, non.
Pour la première fois, le Voyage les séparait.
* Dante Alighieri
*
Depuis que Mort t’a emporté…
Sous la voûte des hauts platanes
feuillage en feu
le cœur se tord
depuis que Mort t’a emporté.
automne
*
Sous la voûte des hauts platanes
cri silencieux
au ciel dressé
le chœur étouffé des troncs nus.
hiver
*
Sous quelle voûte es-tu allé
ô corps aimant
où je voudrais encore nager…
sans printemps
*
Sous quelle voûte notre unité
pulvérisée
depuis que Mort nous a piégés…
ni été
*
Notes de la recluse
à Claude, i.m.
Depuis que tu es parti, je suis recluse, recluse en toi, dans ton absence omniprésente.
*
L’amour tranché fait mal au corps.
Souvent, un corset intérieur me serre le cœur, littéralement. Respirer sans toi est douloureux.
Etreinte de l’Absence.
*
Rêve, au matin.
Tu me tournes le dos. Angoisse.
Tu te retournes et tu m’embrasses sur la bouche. Merveille.
Ainsi, tu viens me retrouver le jour de ton anniversaire, le premier depuis ta mort.
*
Chaque jour, avec une énergie que je n’ai pas, je me jette en ce jardin que tu aimas. Hier, les larmes aux yeux soudain devant l’éclat, l’opulence, la surabondance de tes rosiers en fleurs.
J’en coupe les roses fanées. Mon seau s’emplit de pétales rouges. Rouge sang d’amour.
Cette beauté - dont te prive le sort qui me prive de toi – m’est ta présence.
Au jardin, la pivoine fleurie - brusquement décapitée par la pluie. A l’instant, la vie bascule.
*
Me voici sur le chemin de crête – le regard sur chaque versant, celui des morts où tu es allé, celui des vivants où je suis restée.
Sensation d’étrangeté.
*
Tu es mort : évidence implacable.
Nous sommes séparés à jamais : évidence vertigineuse.
Le vertige s’origine dans cette échappée hors du temps : à jamais.
Echappée palpable.
*
Parfois, au fond de moi – lieu sans lucarne – je me roule en boule : il fait froid sans toi.
*
Toi qui fus si tôt orphelin, une maladie orpheline t’emporta.
Que le hasard est minutieux
*
Jour de mon anniversaire, le premier sans toi.
Le Chat et moi écoutons le chant tibétain choisi pour la cérémonie des adieux.
S’élève une très pure voix de femme – telle la flamme d’une bougie.
S’inaugure l’ère de la Solitude.
*
Ici, vie sans visage.
Je suis entrée en monastère - dans une cellule où tout se bouscule.
*
Une brise, un oiseau, un vol de papillon… : sans cesse, je te guette.
Extraits de Le sabot de Vénus précédé de Implorations minucules, de Françoise Vignet.
© Editions Alcyone
Pour vous procurer le livre de Françoise Vignet :
/ envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : editionsalcyone@yahoo.fr, nous vous enverrons un Bon de commande.
/ Vous pourrez commander ce livre en librairie dès la rentrée de septembre 2022.
/ Cet
ouvrage sera bientôt en vente sur www.amazon.fr (taper : "Françoise Vignet").
Le sabot de Vénus précédé
de Implorations minucules, de Françoise Vignet
Prix global en euros : 15,00€ (+ port /emballage : 4,00€)
Note de lecture sur Le sabot de Vénus précédé de Implorations minuscules par Marc-Henri Arfeux
Tenir la voix pour les absents : Les chants brisés de Françoise Vignet
La poésie n’est jamais simple, même quand elle emprunte et suit jusqu’à leur terme des chemins limpides. Les titres à cet égard nous trompent, mais avec exactitude et fidélité au pacte de pudeur qui permet le chant. Ils nous font pénétrer dans « le leurre du seuil » selon l’un d’entre eux qui est devenu à lui seul l’un des emblèmes de son auteur. Ainsi en va-t-il une fois de plus du nouveau livre de Françoise Vignet : Le sabot de Vénus précédé de Implorations minuscules, récemment publié aux éditions Alcyone, avec d’admirables aquarelles de Claudine Goux. Car derrière ces formulations au lyrisme tendre, c’est le deuil qui se profile, doublement, nous rappelant que la poésie est plus souvent qu’on le pense une expérience du chant brisé qui s’élève de ses propres cendres pour moduler sa perte. Avec elle, celle d’un monde qui, pour continuer d’être, n’en est pas moins, soudain, le désert révélé de l’absence, comme en ces vers qui ouvrent Implorations minuscules dédiées au frère de l’auteure : « L’ossature des arbres, noirs sur un ciel nu – et le couchant laiteux au loin.// Règne du morne. » (p.7).
Un paysage est ici l’écusson de cette absence, comme un autre paysage signera par anticipation un second deuil au début du Sabot de Vénus, dédié cette fois-ci au mari de Françoise Vignet : « Ils avaient déjà appris à voyager léger,/ à franchir les cols,/ à progresser, pas à pas, dans l’immensité des espaces » (p.17). Dans les deux poèmes, l’étendue de la douleur croise une ligne verticale. Le premier se poursuit en effet ainsi : « Seul, un oiseau – là-haut – s’affaire à son chant./ Le lance, le reprend, le détaille.../ Chante, vif invisible, chante à pleine gorge/ ce qui me noue la gorge. ». Dans le second nous lisons : « - plus précisément dans cet espace singulier,/ conquis avec l’endurance de l’arpenteur de montagnes,/ cet espace où terre et ciel s’épousent si bien/ qu’ils épousent aussi ce(ux) qui du monde mortel arrive(nt) là ». Tous deux disent le chant d’impossible présence, tout comme celui de l’inéluctable et inadmissible séparation, l’un par cet oiseau solitaire qui s’entête à chanter de si haut, l’autre par la figure des escarpements de montagne se confondant avec le ciel, et par l’allusion à Dante. C’est une voix sèche, coupante et sobre qui dans le premier cas s’élève, tandis que le second poème développe les anneaux plus amples d’une longue spirale passionnément tendue. L’oiseau donne en effet l’exemple d’un chant funéraire, non pour seulement déplorer mais surtout suivre le défunt et veiller sur lui durant son ascension vers l’inaccessible : « Que ton chant rejoigne celui qui s’éloigne/ Que ton chant lui soit compagnon// en notre infinie douceur ». Dans le second poème, l’espoir lyrique avoue sa défaite par le chant qui l’annonce : « là où,/ au croisement des points cardinaux, les drapeaux de prière/ adressent à l’univers, par la grâce des chevaux du vent,/ leurs paroles bienfaisantes.// (...) Mais l’un et l’autre le savaient : l’un s’envolerait, l’autre, non./ Pour la première fois, le Voyage les séparait. » Ces deux textes inaugurent d’emblée une autre singularité en résonance et différence : le premier s’achève par une date : « 4 mars 2019 » que suivront, tout au long d’Implorations minuscules d’autres références au calendrier. Le second porte un titre : A nous deux, comme le feront tous les poèmes du Sabot de Vénus. D’un côté les saisons de la perte, de l’autre les stations du deuil, l’ensemble formant un vaste oratorio funèbre.
Les Implorations minuscules commencent toujours par un fragment de paysage qui donne à chaque poème sa tonalité, confirmée par la précision d’un mois. Mais du paysage initial à cette référence calendaire, quel autre lien est-il tracé ? Le poème a-t-il été écrit au cours du mois nommé ? On peut le supposer et comprendre que ces brèves éphémérides suivent des oscillations intimes qui trouvent un cadre en un certain moment du monde. Celui-ci, par contraste avec le deuil qu’il accompagne, propose des permanences de la nature : les saisons, l’oiseau, le ciel, l’arbre, ses feuillages, quelques plantes modestes dont la fleur de carotte qui apparaît dans un jardin de haute enfance, comme un baume de la mémoire appliqué à la blessure. Le ciel y est toujours présent, qu’il soit première vision ou apparaisse entre des feuilles. Il est d’abord incitation d’immense par sa nature nomade : « Le ciel est bleu à l’heure changeante. Un vent froid agite les branches.// Au loin se disperse un nuage –poisson volant dont les écailles se détachent. » (p.8). De cette notation atmosphérique naît aussitôt un élan de l’âme : « Emmène-moi, clair pérégrin, vers ceux que j’aime, ceux qui ont franchi les frontières.// Que je flotte parmi l’azur dans ton vaisseau d’outre-terre et qu’à leur rencontre j’aille, pour fêter nos retrouvailles. » La simplicité de l’imploration née de la dissolution d’un nuage au ciel de mars, le choix d’une forme aux lisières du poème en prose ne doivent rien au hasard. Cette sobriété, à peine soulignée de quelques accents, témoigne d’une pudeur dans le deuil, d’une voix retenue qui, plutôt que de laisser son lyrisme se déployer avec emphase, maintient celui-ci dans les limites d’une langue aussi délicate que discrète. A l’image aussi des évocations de la nature qui accompagnent la douleur contenue de l’auteure, lui conférant une sorte de douceur inattendue. Entre le ciel et la sœur évoquant son frère disparu se tisse un lien de confidence.
La façon dont le ciel s’insinue dans les autres poèmes confirme cette impression : « Nuit à peine./Sur le sombre – branches et feuillages s’entremêlent.// Derrière eux le ciel se penche. » (p.9),
« Sous la voûte des hauts platanes, qui m’est refuge, le chagrin n’est pas volage./ Il se recueille, se décline en jeunes feuilles, transparentes de ciel. » (p.9 également). Quelques touches suffisent à rassembler ces paysages à la fois minuscules et vastes puisqu’ils entrelacent des abris de feuillages au ciel ainsi devenu l’une substances élémentaires de cette maison naturelle qui fait du monde un lieu protecteur et méditatif capable d’accueillir et révéler telle qu’en elle-même la tendre plainte. La campagne devient l’alliée de la douleur qu’elle autorise à se rapprocher des morts, comme ici :
« L’air est vif au matin d’hiver – et la campagne, vert amande, sous la mince gelée blanche, soie transparente./Entre le givre et l’herbe, je me glisse, proche des morts aimés. » (p.8). Chaque instant de saison est donc non seulement un état du monde, mais également une suggestion secrète qui ouvre un seuil à l’âme endeuillée. Comme le nuage de tout à l’heure donnait naissance au désir d’un voyage auprès des êtres chers, le matin de gelée blanche rend possible une proximité qui, sans rendre pleine présence, allège et métamorphose le chagrin : « De cet abri éphémère, je lis le monde en son envers – légère, détachée// Bientôt dissoute dans la lumière. » Le ciel n’est pas nommé dans ce poème, mais le mouvement d’inversion qui conduit auprès des morts dans un refuge presque immatériel - non pas sous terre, mais entre « le givre et l’herbe », par un interstice ténu - peut aussi se lire comme un voyage céleste, ainsi que le suggèrent à demi-mot les valeurs de légèreté et de détachement, de même que la conclusion du poème par une dissolution de lumière.
L’avant dernier poème, dont le jeu de transparence entre feuillage et ciel permettait la conjugaison de deux espaces, conduit lui aussi à une méditation du deuil. La saison ayant changé, le climat intérieur en est lui-même affecté. Cependant, la montée de sève et l’éclosion des bourgeons, loin de procurer un soulagement par quelque traditionnelle image de renaissance, renvoie l’endeuillée à sa douleur, dans un regain de chagrin qui constitue le paradoxal printemps de son âme : « Le chagrin se porte en printemps, en pousses drues. / Et l’angoisse fait provision de bourgeons. / Voici venu le temps des brises – le temps brisé. » On ne manquera pas d’entendre en filigrane le contrepoint d’une célèbre chanson populaire, contrepoint qui remplace le mot « cerise » par les « brises ». Jouant de l’allusion aux vents doux et de sa proximité avec le verbe briser, l’auteure brise elle-même la lyre consolante qui discrètement avait momentanément adoucit sa tristesse. Ce ne sera pourtant pas le dernier mot de ce court lamento. Son ultime poème fait en effet surgir tout un monde fragile d’enfance préservée par l’intermédiaire, non du ciel mais de la rustique fleur de carotte que nous mentionnions tout à l’heure : « « Fleur de carotte, ma sauvage, ma toute enfance./ (...) Fleur de carotte, mon étoile des jours solaires, sœur de ta jumelle polaire, l’accueillante des nuits d’été, de tendresse constellée. » (p.10). Pour comprendre toute la portée cosmique de la relation de la fleur de carotte au ciel étoilé, il faut se souvenir de Que ma joie demeure de Jean Giono, où apparaît une image similaire dès l’ouverture du premier chapitre : « C’était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l’herbe. Elles étaient en touffe, avec des racines d’or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. » La correspondance entre le poème de Françoise Vignet et le roman de Jean Giono se précise et se confirme pleinement un peu plus loin, peu après la rencontre des personnages de Jourdan et de Bobi, au cours de la nuit extraordinaire : « Maintenant, toutes les étoiles étaient vraiment comme des fleurs de carotte. » L’enfance magnifiée est elle-même ascension, une ascension d’avant la chute : « Et le marronnier tout en fleurs à peine bouge de haut en bas, tel un vaisseau bien entoilé qui s’apprête à prendre le large – ressurgi d’un temps aboli où les grands frères, garçonnets vifs, campaient dans ses branches fortes.../ (...) C’était avant la vie-cisaille et nous savions grimper aux arbres ! »
Avec Le sabot de Vénus, la douleur du deuil s’accuse de façon plus abrupte. L’être perdu est cette fois l’époux de Françoise Vignet. Il en résulte un texte sans cesse troué par l’absence : « Sous la voûte des hauts platanes,/ feuillage en feu//// le cœur se tord/ depuis que la Mort t’a emporté. »(Depuis que la Mort t’a emporté, p.19). Le poème, cependant, ne se contente pas de cette seule dimension laconique. Il la décline en quatre variations saisonnières, retrouvant ainsi une part de l’inspiration d’Implorations minuscules. Déjà la présence d’arbres tutélaires en offrait un écho. Chacune de ces saisons, accompagnée à la fin de son nom, forme donc un court poème à l’intérieur de l’ensemble, qui est tout autant un seul poème qu’une séquence aux motifs obsessionnels et groupée sous un titre commun. La reprise du premier vers « Sous la voûte des hauts platanes » (p.19), puis sa légère métamorphose : « Sous quelle voûte es-tu allé », (p.20) « Sous quelle voûte notre unité », (p.20), non seulement relie ces quatre poèmes mais leur donne également la valeur musicale d’un ostinato. Entre reprise scandée d’une sorte de profération conjuratoire et variations successives, le poème explore le cycle entier d’une même douleur autour d’une implacable année d’absence. Ainsi, après l’automne, c’est au tour de l’hiver de proposer sa propre version de la dure nudité du deuil : « « Sous la voûte des hauts platanes// cri silencieux/ au ciel dressé// le chœur étouffé des troncs nus. » Le printemps (en réalité nommé sans printemps, d’une façon symbolique qui rappelle aussi sa contradiction dans Implorations minuscules) ose une question et s’abandonne à un discret tremblement lyrique : « Sous quelle voûte es-tu allé/ ô corps aimant// où je voudrais encore nager... ». L’été (désigné par une autre dénégation : ni été), offre enfin une ultime variation où se retrouve le dispositif d’un vide étendu largement entre début et fin du texte, le nom de la mort surgissant comme un infranchissable obstacle par le monument du « m » majuscule : « Sous quelle voûte notre unité//// pulvérisée/depuis que la Mort nous a piégés... ».
Ce vide se dispose parfois autrement, comme dans la suite des poèmes groupés sous le titre Notes de la recluse où le texte est constitué de brèves formulations de quelques vers, parfois réduites à une seule phrase. Chacune est une des facettes de la même impossible traversée, celle d’un deuil cellule où la survivante n’a que le vide entre les mots pour articuler sa douleur : « Ici, vie sans visage./ Je suis entrée en monastère – dans une cellule où tout se bouscule. » (p.24). De même : « Parfois, aufond de moi – lieu sans lucarne – je me roule en boule : il fait froid sans toi. » (p.23). Comme dans Depuis que la Mort t’a emporté, la parole, réduite au constat de l’irréparable privation, ne parvient à soutenir ce défi qu’en comprimant son cri. Par exemple en lui substituant la beauté fascinante d’une pure énigme : « Devant la fenêtre de décembre, cette rose rouge – qu’un chevreuil a gracié. » (p.26). Ou bien en questionnant sans relâche l’impossible : « SI l’Invisible existe, pourquoi ne pas te rejoindre ? » (p.27). Ou encore en tenant le journal d’un temps sans issue quelquefois sublimé :
« Journée désolée./ Au crépuscule cependant s’installe au sommet des arbres une chaude lumière, entre le cuivre et l’or – telle une caresse vivante./ M’emplit alors une finie douceur. » (p.28). Cet apparent répit ne doit pas nous tromper. Le chemin du deuil n’a pas de fin, comme le souligne à lui seul le titre dubitatif du poème intitulé Épilogue ? qui succède immédiatement aux Notes de la recluse. La voix tenue, dans un dédoublement d’elle-même devient alors vision : « Mais d’un sentier qui surplombe une haute falaise de pierre brun rouge, je te vois, cavalier à cheval, t’élancer dans le vide parmi les airs étincelants –bientôt descendre au profond des eaux si transparentes que je peux suivre du regard ta silhouette qui poursuit sa plongée – précise forme humaine, mi-nageant, mi-dansant, devançant l’animal – agile au sein de la mer qui resplendit, agile au sein d’un océan de lumière... » (p.30). Le changement de taille des caractères et le passage à l’italique, fréquent à certains détours de l’étrange récit que finit par former l’ensemble du livre, renforce l’impression de passer la frontière entre deux mondes, celui de la survie dans les larmes et celui de la vie ravagée dans l’abîme, tout devenant parabole, descente aux lumineux enfers d’une oppression apparemment irrémédiable. Poreux, les poèmes laissent alors passer, non seulement la forme négative du défunt, mais encore le plasma des hantises emblématiques.
Tel est le cas de Du Passage (p.31) où alternent constats définitifs, questions sans réponse, reprise du même thème onirique : « De temps à autre cependant, tu apparais, passant mystérieux quoique familier, dans mes rêves./ Il y a peu, cavalier à cheval, tu t’élançais dans les airs lumineux du haut de la falaise abrupte jusqu’au profond dela mer étincelante. » Tenir la voix signifie alors garder la haute main sur le langage afin de circonscrire dans le sens ce qui n’en a pas, ce chaos d’être et de non-être, quitte à contaminer les mots par espoir de silence, comme dans Mal aux mots qui semble autant proférer une malédiction que constater un état morbide du langage : « Leur mal m’a fait mal, leur mal m’a troublée./ / Ils étaient en lambeaux : je n’ai su les identifier. » (p.35). A cette décomposition blessante s’oppose le désir d’une absence absolue dont le poème contourne l’angoissante utopie : « Moi qui désirais un silence dépouillé – tel un morceau d’espace vide, enfin.// Moi qui désirais un silence sans mots ni morts – telle une mandorle où m’abriter, autour de son Absence. » La volonté régressive de s’incorporer au noyau de la perte peut cependant s’inverser dans certaines circonstances où « Parfois, une miette de l’Ailleurs vient livrer au temps sa profondeur vivante » (Temps-sans-Toi, p.38).
Peut-être est-ce la raison profonde du poème final : Quand chantera l’érable pourpre (p.39). Celui-ci en effet semble formuler un espoir, mais lequel ? Le poème laisse volontairement flotter parmi les « peut-être » les réponses à cette question, comme si la promesse qu’il semble envisager restait encore fragile. La voix n’est plus alors seulement tenue, mais devient le prélude d’un chant à venir dont on ne sait s’il sera celui d’une vie retrouvée ou d’un automne, accepté et accompli, comme si de cette hésitation dépendait la plus profonde maturation de la mort et de celle qui la porte : « Peut-être son chant végétal te parviendra-t-il par-delà ces jours esseulés d’ici-bas et les sphères qui nous séparent quand viendra un rai de lumière// Peut-être ta peine fondra dans la mienne devenue joie/ton sourire viendra sur mes lèvres, je te porterai dans ma voix// Peut-être.../ Quand chantera l’érable pourpre ».
Texte de Marc-Henri Arfeux